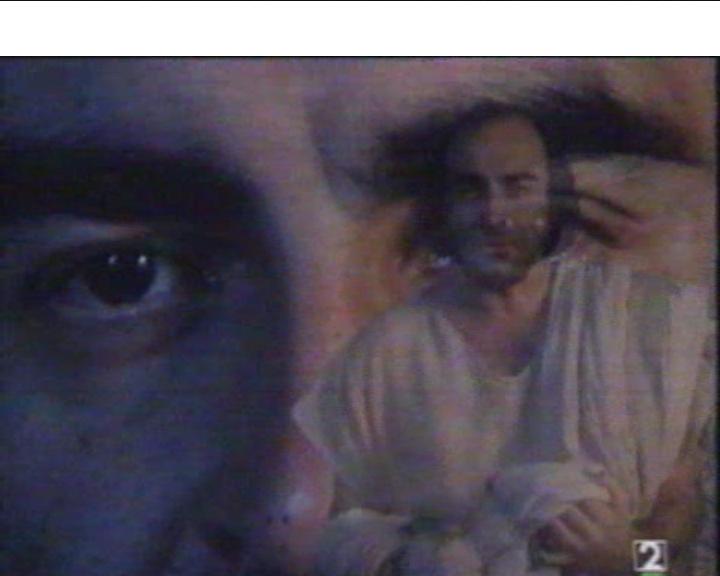
« Philosophie » est en fait un double mot, constitué de deux racines grecques : φιλειν (philein) et σοφια (sophia). La première signifie « aimer », la seconde « la sagesse ». Ainsi le mot φιλοσοφια (philosophie) désigne t-il une activité qu’on pourrait appeler « amour de la sagesse », et cette expression est d’emblée riche en réflexion, puisqu’on peut d’ores et déjà se demander s’il est véritablement légitime d’utiliser le terme « activité » pour une discipline qui relèverait de l’amour. L’amour n’entre pas dans la catégorie des activités. Reste à savoir à quelle catégorie elle appartient pour déterminer ce que les grecs entendaient quand ils utilisaient cette expression.
Il se trouve que la Grèce antique nous a légué un texte dont le moteur central est précisément ce concept subtil qu’est l’amour. Platon en est l’auteur, comme toujours Socrate en est le personnage principal mais non exclusif, comme toujours aussi, il s’agit d’un dialogue, intitulé Le Banquet. Il s’agit donc d’un repas, au cours duquel les convives (dont fait partie Socrate) se lancent comme défi de proposer le meilleur éloge de l’amour. Le passage qui va nous intéresser ici est celui au cours duquel Aristophane, auteur comique contemporain de Socrate va utiliser un mythe populaire pour décrire ce sentiment particulier qu’est l’amour. Ce mythe est celui des androgynes. Comme tous les mythes, ils ne fonctionnent qu’à la condition de s’y confronter. Il est donc nécessaire que je laisse ici la parole à Aristophane lui-même (NB : pour ceux qui auraient du mal à lire sur écran ce genre de texte (exercice effectivement pénible), rappelons que rien ne vaut la lecture des livres eux même. Mais si les livres sont aussi un effort trop grand, j’ai mis dans le module « radioblog », en index 4.01, la lecture que le comédien Michael Lonsdale en fait dans le coffret de lecture intégrale du Banquet).

Ensuite, la forme de chaque homme constituait un tout, avec un dos arrondi et des flancs bombés. Ils avaient quatre mains, le même nombre de jambes, deux visages tout à fait pareils sur un cou parfaitement rond; leur tête, au-dessus de ces deux visages situés à l’opposé l’un de l’autre, était unique; ils avaient aussi quatre oreilles, deux organes de la génération, et le reste à l’avenant, autant qu’on peut l’imaginer. Ils se déplaçaient ou bien en ligne droite, comme à présent, dans le sens qu’ils voulaient; ou bien quand ils se mettaient à courir rapidement, ils opéraient comme les acrobates qui exécutent une culbute et font la roue en ramenant leurs jambes en position droite: ayant huit membres qui leur servaient de points d’appui, ils avançaient rapidement en faisant la roue. La raison pour laquelle il y avait trois genres, et conformés de la sorte, c’est que le mâle tirait son origine du soleil, le femelle de la terre, et le genre qui participait aux deux de la lune, étant donné que la lune elle aussi participe des deux autres. Circulaire était leur forme et aussi leur démarche, du fait qu’ils ressemblaient à leurs parents. De là leur force terrible, et leur vigueur, et leur orgueil immense. Ils s’attaquèrent aux dieux, et ce que raconte Homère au sujet d’Ephialte et Otos concerne les hommes de ce temps-là : ils tentèrent d’escalader le ciel, pour combattre les dieux.
Alors Zeus et les autres dieux se demandèrent quel parti prendre : ils étaient bien embarrassés. Ils ne pouvaient en effet les tuer, et détruire leur espèce en les foudroyant comme les Géants, car c’était perdre complètement les honneurs et les offrandes qui leur venaient des hommes; mais ils ne pouvaient non plus tolérer leur insolence. Après avoir laborieusement réfléchi, Zeus parla: « Je crois, dit-il, tenir un moyen pour qu’il puisse y avoir des hommes et que pourtant ils renoncent à leur indiscipline: c’est de les rendre plus faibles. Je vais maintenant, dit-il, couper par moitié chacun d’eux. Ils seront ainsi plus faibles, et en même temps ils nous rapporterons davantage, puisque leur nombre aura grandi. Ils marcheront droits sur deux jambes, mais s’ils se montrent encore insolents et ne veulent pas rester tranquilles, je les couperai en deux une fois de plus, et dès lors ils marcheront sur une seule jambe, à cloche-pied’. Ayant ainsi parlé, il coupa les hommes en deux, comme on coupe les cormes pour les mettre en conserve, ou comme on coupe les oeufs avec un crin. Quand il en avait coupé un, il demandait à Apollon de lui retourner le visage et la moitié du cou, du côté de la coupure, pour que l’homme, ayant sous les yeux la coupure qu’il avait subie, fut plus modeste, et il lui demandait de guérir le reste. Apollon retournait alors le visage et, ramenant de toutes part la peau sur ce qui s’appelle a présent le ventre, comme on fait avec les bourses à cordons, il l’attachait fortement au milieu du ventre en ne laissant qu’une ouverture – ce qu’on appelle le nombril. Puis il effaçait la plupart des plis qui subsistaient, il modelait exactement la poitrine avec un outil pareil à celui qu’emploient les cordonniers pour aplanir sur la forme les plis du cuir. Il laissa pourtant quelques plis, ceux qui se trouvent dans la région du ventre et du nombril, comme souvenir du traitement subi jadis.

Chacun d’entre nous est donc une fraction d’être humain dont il existe le complément, puisque cet être a été coupé comme on coupe les soles, et s’est dédoublé. Chacun, bien entendu, est en quête perpétuelle de son complément. Dans ces conditions, ceux des hommes qui sont une part de ce composé des deux sexes qu’on appelait alors androgyne, sont amoureux des femmes, et c’est de là que viennent la plupart des hommes adultères; de la même façon les femmes qui aiment les hommes et qui sont adultères, proviennent de cette espèce; quant à celles de femmes qui sont une part de femme, elles ne prêtent aucune attention aux hommes, leur inclination les porte plutôt vers les femmes, et c’est de cette espèce que viennent les petites amies des dames. Ceux qui sont une part de mâle recherchent les mâles et, tant qu’ils sont enfants, comme ils sont de petites tranches du mâle primitif, ils aiment les hommes, prennent plaisir à coucher avec eux, à être dans leurs bras. Ce sont les meilleurs des enfants et des jeunes gens, parce qu’ils sont les plus virils de nature. Certains disent, bien sur, qu’ils sont impudiques, mais c’est faux. car ils n’agissent pas ainsi par impudicité : non, c’est leur hardiesse, leur virilité, leur air mâle, qui les fait chérir ce qui leur ressemble. En voici une bonne preuve : quand ils sont complètement formés, les garçons de cette espèce sont les seuls à se montrer des hommes, en s’occupant de politique. Devenus des hommes, ils aiment les garçons; le mariage et la paternité ne les intéressent guère – c’est leur nature; la loi seulement les y contraint, mais il leur suffit de passer leur vie côte à côte, en célibataires. En un mot l’homme ainsi fait aime les garçons et chérit les amants, car il s’attache toujours à l’espèce dont il fait partie.

La raison en est que notre nature originelle était comme je l’ai dit, et que nous formions un tout : le désir de ce tout et sa recherche a le nom d’amour. Auparavant, comme je l’affirme, nous étions un. Mais maintenant, pour nos fautes, nous avons été séparés d’avec nous-mêmes par le dieu, tout comme les Arcadiens l’ont été par les Lacédémoniens. Nous devons donc craindre, si nous ne respectons pas nos devoirs à l’égard des dieux, d’être une fois de plus fendus par le milieu, et de nous promener pareils aux personnages qu’on voit figurés de profil en bas-relief sur les stèles, coupés en deux selon la ligne du nez, et semblables à des moitiés de jetons. Voilà pourquoi l’on doit exhorter tout homme à la piété, en toute chose, à l’égard des dieux, afin que nous échappions à un état et que nous parvenions à l’autre, comme le veut l’Amour, notre guide et notre chef. A lui, que personne ne s’oppose – et c’est s’opposer à lui que de se rendre haïssable aux dieux. Car si nous devenons les amis de ce dieu, si nous faisons notre paix avec lui, nous découvrirons et nous rencontrerons les bien-aimés qui nous appartiennent en propre, ce que peu de gens à présent réalisent. Qu’Eryximaque ne s’en prenne pas à moi, et ne tourne pas en dérision mes paroles, sous prétexte que je parle de Pausanias et d’Agathon : ils sont probablement de ce nombre, et tous deux sont de nature mâle. Je parle, moi, des hommes et des femmes dans leur ensemble, et je déclare que notre espèce peut être heureuse si nous menons l’amour à son terme et si chacun de nous rencontre le bien-aimé qui est le sien, retrouvant ainsi sa nature première. Si tel est l’était le plus parfait, il s’ensuit forcément quem dans le présent, ce qui s’en rapproche le plus est aussi la chose la plus parfaite, et c’est la rencontre d’un bien-aimé selon notre âme.

Platon, Le Banquet, 189d – sq, trad. L. Brisson, Flammarion coll. GF
Très long extrait, mais extrait nécessaire d’une part parce qu’il nous permet de mieux saisir pour quelles raisons la philosophie est un amour et non une connaissance de la sagesse, d’autre part parce qu’il servira de fondation à la manière dont l’occident concevra le désir amoureux par la suite. Le récite d’Aristophane « parle » par lui même, apportons lui tout de mpele quelques précisions. La première sera très concrète mais permettra de saisir ce que sont ces androgynes. En effet, la mémoire collective retiendra qu’ils sont l’assemblage d’une moitié mâle et d’une moitié femelle. On pourrait dès lors se demander pourquoi Aristophane, en début de récit, mentionne trois catégories de créatures : cela signifie t-il qu’il y aurait des hommes et des femmes (tels que nous les connaissons aujourd’hui) aux côtés des androgynes ? Non, la suite du texte le démontre en parlant des multiples configurations de l’amour : en ce « temps » mythologique existaient les androgynes, constituées de moitiés différenciées sexuellement, mais aussi deux autres catégories constituées de moitiés non différenciées. C’est peu important pour ce qui nous occupe ici (rappelons le : la compréhension de ce qu’est la philosophie) mais cela permet de comprendre le texte de manière plus générale.
Sans entrer dans le détail du découpage des créatures doubles, on peut noter ceci : si nous étions auparavant doubles, si nous avons été amputés de notre moitié, on peut comprendre que l’on cherche à se « recomposer ». Le mythe des androgynes définirait donc l’amour dans ses deux temps : tout d’abord le temps de l’absence, qui est le temps du manque d’amour, perçu comme un manque essentiel, constituant une sorte de trou dans l’existence (on pourrait discuter longuement de ce sentiment de vide, se demander si il est vraiment essentiel ou s’il n’est pas plutôt dicté par des exigences liées aux normes sociales), puis le temps de l’accomplissement, qui serait celui au cours duquel on retrouverait cette « moitié » perdue (et on mesure bien, ici, à quel point le vocabulaire contemporain est encore très marqué par ce mythe fondateur). L’amour serait donc double : tout d’abord manque, mouvement provoqué par une sorte d’appel d’air, vertige, puis contentement, sérénité de l’unité retrouvée, bonheur de s’être retrouvé. Ce serait là un double temps dont on pourrait parler si le second était possible. En effet, ne s’étant jamais vus (ils se tournaient le dos), les amants ne peuvent jamais avoir la certitude d’avoir retrouvé l’unité perdue. D’ailleurs, les détails donnés par Aristophane sur ce qui arrive lorsque l’un des deux amants meurt montrent qu’en amour c’est toujours le manque qui prend le dessus et qui continue, sans cesse, de tenailler l’homme amputé. Ainsi, le passage dans lequel Aristophane imagine Héphaïstos débarquant avec forge et outils dans la chambre des amants pour leur proposer de les souder l’un à l’autre définitivement montre finalement par l’absurde qu’une telle intensité d’amour, qu’une telle certitude n’est pas de ce monde, et qu’elle serait inhumaine. Cette distance entre les amants demeure. Ils peuvent se retrouver dans le vaste monde, s’approcher, entrer en contact l’un avec l’autre, se serrer dans leurs bras, mais aussi fort puissent ils serrer, la fusion ne sera pas possible. Tout ce qu’ils peuvent tenter, c’est tendre l’un vers l’autre, et ce à l’infini.

Le philosophe est donc celui qui sait que la sagesse lui échappe perpétuellement. C’est pour cette raison que la philosophie ne peut naître que dans l’ignorance. Le sage sait. Il dispose non seulement de la connaissance théorique sur le monde, mais il sait aussi comment s’y comporter. Souvenons nous de Blaise Pascal qui se trouvait dans le monde comme sur une île déserte dont il ne saurait rien, et dans laquelle il ne savait ce qu’il était censé faire. Dans une telle île, le sage est celui qui a vu ce que les autres n’ont pas vu, celui qui a reçu un message lui indiquant où il est, et ce qu’on attend de lui. A celui qui reçoit un tel message et a confiance dans ses sources, on pourrait donner le nom de sage, pour autant qu’on croit qu’il est illuminé de l’extérieur, et non de l’intérieur. Mais celui qui ne dispose pas de ces informations doit soit se détourner dans le divertissement, soit se lancer dans la recherche. Cette dernière option est celle du philosophe.
On peut se demander pourquoi se mettre en tel chemin si c’est pour ne jamais parvenir. C’est une objection souvent faite à la philosophie. On pourrait répondre en bottant en touche : la longueur infinie du voyage donne t-elle plus de valeur au repos ? Est-ce que la position arrêtée a une quelconque valeur face à un objectif qui est hors d’atteinte ? En d’autres termes, en géométrie, le point a-t-il plus de valeur dans un segment de droite, ou dans une droite ? Le fait qu’en philosophie on ne parvienne jamais à posséder l’objet recherché ne retire en rien la nécessité de se mettre en chemin. D’une part parce que ce chemin existe, d’autre part parce qu’il soulève des questions qui sont essentielles, même si on fait tout pour les éviter. Mais surtout, le caractère asymptotique de la réflexion philosophique permet à tous de s’y lancer. Il n’y a pas de moment où on puisse se dire que le chantier est achevé : il y a une progression, mais chaque nouveau voyageur de la pensée peut tracer une trajectoire neuve sur un territoire vaste, où l’on se croise parfois, mais où il s’agit de pousser toujours plus loin les chemins, même s’ils ne mènent nulle part.
Illustrations : images extraites du film « Le Banquet » de Marco Ferreri. Film presque introuvable dans les circuits classiques, peu diffusé et non encore édité en format DVD. Le film est intéressant, il alterne les scènes du banquet en lui-même avec des passages qui racontent l’évènement après coup, permettant d’en mettre certains aspects en perspective et de rompre le huis-clos. Les discours en eux mêmes sont par moments accompagnés d’illustations allégoriques qui permettent de coller au mieux avec le style d’écriture de Platon, alternant elle aussi les passages analytiques et les références mythiques. Le discours d’Aristophane, en particulier, est illustré d’images d’enfants, rappelant ainsi l’aube de l’humanité, dans un rapport innocent et étonné au corps, comme si l’humanité se découvrait telle qu’elle est. L’idée intéressante ici étant de les poser sur une surface réfléchissante, de sorte qu’ils sont finalement confrontés à eux mêmes, comme s’ils se cherchaient, tout comme les androgynes défaits tentent de se recomposer.
Dans l’ordre des illustrations :
1 – Aristophane dédoublés par une superposition décrit la manière dont on découpe les androgynes (et donc comment on constitue les humains)
2 – Les enfants dos à dos illustrent ce que pouvaient être les androgynes tels qu’ils sont décrits dans le discours d’Aristophane. Nous ne verrons à aucun moment une représentation réaliste de ces créatures, qui du point de vue du récit comme du point de vue de l’image, resteront mythiques.
3 – Aristophane prend l’un des convives sur son dos pour mimer la démarche et le déplacement des androgynes. Ici aussi, le mime permet d’éviter la représentation réaliste, qui ferait passer le récit d’un statut mythique à un statut historique.
4 – L’enfant seul face à son image reflétée est tout autant une image de la prise de conscience de l’identité absolument seule qu’une illustration du manque lié à la séparation. N’ayant jamais vu sa moitié, chacun n’a comme image de soi que ce qu’il en voit en reflet.
5 – L’intervention d’Hephaïstos met en scène la puissance de l’amour. A l’image, la proposition de soudure définitive des amants est illustrée par les torrents de lave déferlant en arrière plan. Ceux ci sont bien sûr tout autant une illustration littérale de la puissance des forges d’Hephaïstos qu’une allégorie de la puissance reproductrice de l’amour humain. Pour preuve, la femme enceinte qui repose, sereine, devant les flammes.
6 – On passe de l’enfant seul devant sa propre image aux enfants ensemble délaissant leur image pour s’intéresser aux autres. La distance avec sa propre image est infranchissable dans la mesure où on ne peut faire qu’un avec son reflet. La distance avec les autres l’est tout autant. L’amour est la synthèse de ces deux distances, par lesquelles ce qui nous sépare de l’autre est aussi ce qui nous sépare de nous même.
j’ai apprecier votre introduction et j’aimerais comprendre ce que s’est que la philosophie plus que celle ci
merci