Mes étudiants de BTS travaillent cette année, en culture générale, sur un thème qu’on peut attaquer sous bien des angles : « A toute vitesse ». Et parmi les documents que nous avons étudiés ensemble, il y l’entrée en matière du roman d’Emile Zola, la Curée, qui met en scène un véritable embouteillage de voitures hippomobiles, pour mieux planter là la bourgeoisie de la fin du 19ème en plein bois de Boulogne, dans sa collection de voitures d’époque. On pourrait croire ces véhicules désormais inutiles, puisqu’ils ne peuvent plus rouler. Mais on n’a pas attendu le 21ème siècle pour faire de la voiture un signe, davantage qu’un outil. Et dans ce qui suit, on va découvrir l’incroyable quantité de modèles existant, et la façon dont se petit monde se regarde déjà d’habitacle en habitacle. On va aussi, évidemment, étudier de quelle façon Zola construit une image figée d’une classe sociale qui aime se représenter en mouvement.
Et si vous avez envie d’en lire plus sur la façon de se tenir dans un véhicule de prestige, je pense que mon étude de la custode constituera un complément à la lecture de cet article.

« Au retour, dans l’encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche dut marcher au pas. Un moment, l’embarras devint tel qu’il lui fallut même s’arrêter.
Le soleil se couchait dans un ciel d’octobre, d’un gris clair, strié à l’horizon de minces nuages. Un dernier rayon, qui tombait des massifs lointains de la cascade, enfilait la chaussée, baignant d’une lumière rousse et pâlie la longue suite des voitures devenues immobiles. Les lueurs d’or, les éclairs vifs que jetaient les roues semblaient s’être fixés le long des réchampis[2] jaune paille de la calèche, dont les panneaux gros bleu reflétaient des coins du paysage environnant. Et, plus haut, en plein dans la clarté rousse qui les éclairait par derrière, et qui faisait luire les boutons de cuivre de leurs capotes à demi pliées, retombant du siège, le cocher et le valet de pied, avec leur livrée bleu sombre, leurs culottes mastic et leurs gilets rayés noir et jaune, se tenaient raides, graves et patients, comme des laquais de bonne maison qu’un embarras de voitures ne parvient pas à fâcher. Leurs chapeaux, ornés d’une cocarde noire, avaient une grande dignité. Seuls, les chevaux, un superbe attelage bai, soufflaient d’impatience.
— Tiens, dit Maxime, Laure d’Aurigny[3], là-bas, dans ce coupé… Vois donc, Renée.
Renée se souleva légèrement, cligna les yeux, avec cette moue exquise que lui faisait faire la faiblesse de sa vue.
— Je la croyais en fuite, dit-elle… Elle a changé la couleur de ses cheveux, n’est-ce pas ?
— Oui, reprit Maxime en riant, son nouvel amant déteste le rouge.
Renée, penchée en avant, la main appuyée sur la portière basse de la calèche, regardait, éveillée du rêve triste qui, depuis une heure, la tenait silencieuse, allongée au fond de la voiture, comme dans une chaise longue de convalescente. Elle portait, sur une robe de soie mauve, à tablier et à tunique, garnie de larges volants plissés, un petit paletot de drap blanc, aux revers de velours mauve, qui lui donnait un grand air de crânerie. Ses étranges cheveux fauve pâle, dont la couleur rappelait celle du beurre fin, étaient à peine cachés par un mince chapeau orné d’une touffe de roses du Bengale. Elle continuait à cligner des yeux, avec sa mine de garçon impertinent, son front pur traversé d’une grande ride, sa bouche, dont la lèvre supérieure avançait, ainsi que celle des enfants boudeurs. Puis, comme elle voyait mal, elle prit son binocle, un binocle d’homme, à garniture d’écaille, et, le tenant à la main sans se le poser sur le nez, elle examina la grosse Laure d’Aurigny tout à son aise, d’un air parfaitement calme.
Les voitures n’avançaient toujours pas. Au milieu des taches unies, de teinte sombre, que faisait la longue file des coupés, fort nombreux au Bois par cet après-midi d’automne, brillaient le coin d’une glace, le mors d’un cheval, la poignée argentée d’une lanterne, les galons d’un laquais haut placé sur son siège. Çà et là, dans un landau découvert, éclatait un bout d’étoffe, un bout de toilette de femme, soie ou velours. Il était peu à peu tombé un grand silence sur tout ce tapage éteint, devenu immobile. On entendait, du fond des voitures, les conversations des piétons. Il y avait des échanges de regards muets, de portières à portières ; et personne ne causait plus, dans cette attente que coupaient seuls les craquements des harnais et le coup de sabot impatient d’un cheval. Au loin, les voix confuses du Bois se mouraient.
Malgré la saison avancée, tout Paris était là : la duchesse de Sternich, en huit- ressorts[4] ; Mme de Lauwerens, en victoria[5] très correctement attelée ; la baronne de Meinhold, dans un ravissant cab[6] bai-brun ; la comtesse Vanska, avec ses poneys pie ; Mme Daste, et ses fameux stappers[7] noirs ; Mme de Guende et Mme Tessière, en coupé ; la petite Sylvia, dans un landeau gros bleu. Et encore don Carlos, en deuil, avec sa livrée antique et solennelle ; Selim Pacha, avec son fez et sans son gouverneur ; la duchesse de Rozan, en coupé-égoïste[8], avec sa livrée poudrée à blanc ; M. le comte de Chilbray, en dog-cart[9] ; M. Simpson, en mail[10] de la plus belle tenue ; toute la colonie américaine. Enfin deux académiciens en fiacre.
Les premières voitures se dégagèrent et, de proche en proche, toute la file se mit bientôt à rouler doucement. Ce fut comme un réveil. Mille clartés dansantes s’allumèrent, des éclairs rapides se croisèrent dans les roues, des étincelles jaillirent des harnais secoués par les chevaux. Il y eut sur le sol, sur les arbres, de larges reflets de glace qui couraient. Ce pétillement des harnais et des roues, ce flamboiement des panneaux vernis dans lesquels brûlait la braise rouge du soleil couchant, ces notes vives que jetaient les livrées éclatantes perchées en plein ciel et les toilettes riches débordant des portières, se trouvèrent ainsi emportés dans un grondement sourd, continu, rythmé par le trot des attelages. Et le défilé alla, dans les mêmes bruits, dans les mêmes lueurs, sans cesse et d’un seul jet, comme si les premières voitures eussent tiré toutes les autres après elles.
Renée avait cédé à la secousse légère de la calèche se remettant en marche, et, laissant tomber son binocle, s’était de nouveau renversée à demi sur les coussins. Elle attira frileusement à elle un coin de la peau d’ours qui emplissait l’intérieur de la voiture d’une nappe de neige soyeuse. Ses mains gantées se perdirent dans la douceur des longs poils frisés. Une bise se levait. Le tiède après-midi d’octobre, qui, en donnant au Bois un regain de printemps, avait fait sortir les grandes mondaines en voiture découverte, menaçait de se terminer par une soirée d’une fraîcheur aiguë.
Un moment, la jeune femme resta pelotonnée, retrouvant la chaleur de son coin, s’abandonnant au bercement voluptueux de toutes ces roues qui tournaient devant elle. »
Emile Zola ; la Curée, 1871

Des embarras à l’embouteillage
On est surpris, ces temps-ci, de découvrir nos avenues, notre périphérique, nos voies rapides et, au-delà des étendues urbaines, les nationales, les autoroutes, désertes, vidées des véhicules pour lesquels ces voies dédiées à la circulation ont été construites. Et on est persuadé qu’on est revenu quelques décennies en arrière, à une époque qu’on imaginer dater de la deuxième moitié du 20ème siècle, durant laquelle les automobiles étaient rares, et les encombrements inexistants. Parce qu’on pense un peu naïvement que les voitures se sont trouvées bêtement enfermées dans les embouteillages au moment même où elles devenaient performantes, on croit aussi qu’il n’y a pas si longtemps qu’elles s’entassent les unes derrière les autres, immobilisées comme un sang trop épais englué dans des artères mal ramonées, encrassées par les excès de toutes sortes. Pourtant, nous nous trompons. Au 17ème siècle déjà, Boileau dans ses Embarras de Paris, décrivait la frénésie urbaine quand un bruissement sans fin qui s’interdit tout repos et empêche le sommeil. Paris y paraît encombrée, débordante, et déjà les véhicules, nécessairement accompagnés de la ménagerie animale qui devait bien leur servir de moteur, s’accumulent dans les boulevards, et se font obstacle les uns les autres dans les carrefours, dans un chaos que les mots de Boileau restituent sous la forme d’un amoncellement de micro-évènements qui, ajoutés les uns aux autres, occupent l’espace et le temps des alexandrins jusqu’à produire un foisonnement grouillant qui semble ne connaître ni début ni fin.
Mais si Boileau met en scène l’effervescence et le mouvement perpétuel de la ville, à la fin du 19ème siècle, les premières pages du roman d’Emile Zola, la Curée, s’ouvrent, elles, sur un embouteillage. Pourtant, en 1871, l’automobile n’existe pas encore. Mais la voiture hippomobile, elle, est omniprésente, tout particulièrement chez la bourgeoisie qui l’utilise pour ne pas avoir à prendre les transports collectifs. Déjà, la voiture individuelle permet de ne pas se mélanger aux autres, et de se distinguer. Un des aspects marquant de cet incipit[11], c’est la force des détails, qui oblige le lecteur du 21ème siècle à aller chercher sur les sites spécialisés ce à quoi correspondent les nombreuses appellations des modèles de véhicules accumulés dans une belle unité de lieu, de temps, et d’inaction. A quoi s’ajoute une description très minutieuse de tous les détails de cette scène immobile, et pourtant gorgée de cette agitation spécifique, propre à cette classe sociale aisée, et fière de montrer qu’elle l’est, en cette fin de 19ème siècle. C’est ce mélange d’énergie potentielle, cinétique et économique, qui fait la force de ce texte, et aussi son paradoxe : on y accumule les signes extérieurs de vitesse, mais pour mieux les exhiber, on se satisfait de leur immobilité. Ce faisant, Emile Zola capte quelque chose qui est sans doute un des traits marquants de la bourgeoisie : elle met d’autant plus en scène le mouvement qu’elle désire en fait profondément le statu quo.
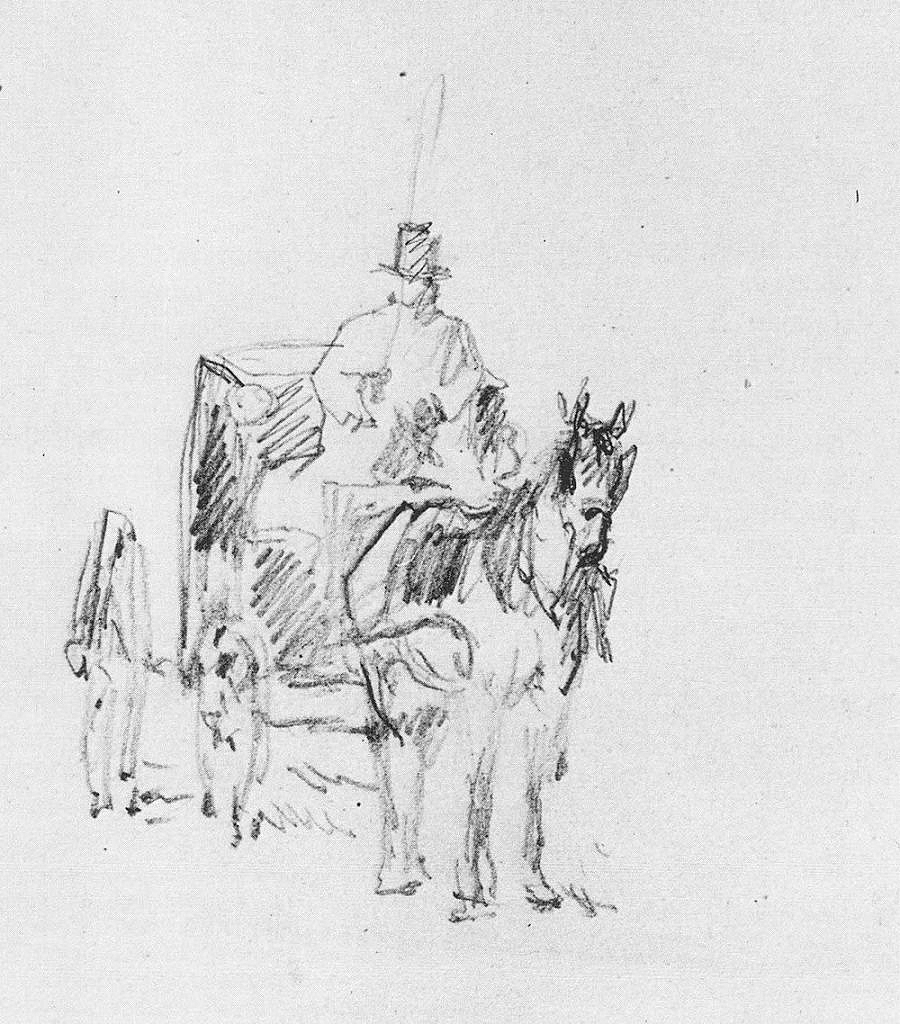
Previously, in the Rougon-Macquart
Les entrées en matière sont cruciales. On doit toujours avoir les yeux grands ouverts sur le premier plan d’un film, car il dit tout. Et on devrait lire tout aussi attentivement les premiers mots d’un roman, car tout ce qui suivra s’y trouve déjà. La Curée commence ainsi : « Au retour, dans l’encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche dut marcher au pas. Un moment, l’embarras devint tel qu’il lui fallut même s’arrêter. » Mouvement et immobilité mêlés. Accélération et freinage plus exactement. Tout d’abord, parce que les objets présents dans cette scène sont censés se déplacer rapidement, et pourtant ils sont contraints à ralentir, et à s’arrêter pour de bon. Les voitures sont par essence un moyen de déplacement. Le mot lui-même existe depuis le 13ème siècle, et le verbe voiturer désigne alors le fait de se rendre en Terre sainte. Entre temps, la voiture est devenue un objet qui signifie le mouvement tout autant qu’il le permet. Et comme jadis la noblesse utilisait des armoiries, des blasons ou des oriflammes pour signifier son autorité, son pouvoir et sa place dans la longue chaîne hiérarchique qui organisait la souveraineté, la bourgeoisie de la fin du 19ème utilise des objets comme signes de pouvoir. Parmi ceux-ci, les voitures remplacent peu à peu les armes, et s’associent au vêtement pour dire quelque chose de soi aux yeux des autres. Dès lors, il n’est plus forcément utile que la voiture se déplace. A elle seule, elle est un signe de puissance. Mais l’effet de mouvement, dans cette ouverture, est d’emblée provoqué par ces deux mots qui supposent quelque chose qui les a précédés : « au retour ». Il n’y a pas de retour sans aller, et celui-ci précède nécessairement celui-là. On prend donc le train du récit en marche.
Et cette marche a bel et bien débuté avant la première page du roman, car la Curée est le second volume d’un projet au long cours qu’Emile Zola a inauguré avec la Fortune des Rougon, et auquel il donne le nom de la famille dont cette série de romans va constituer le portrait, mais aussi l’étude quasi génétique, sur plusieurs générations. La série entière s’intitule les Rougon-Macquart, et c’est cette façon d’étudier quasi scientifiquement, comme un entomologiste classant des insectes, cette famille, ses mœurs, ses mariages, ses alliances, ses enfants, les méthodes grâce auxquelles ils vont s’enrichir sous le second-empire, qui distingue le projet d’Emile Zola de celui qui l’a inspiré, la Comédie humaine de Balzac, qui se présente davantage comme une galerie de personnages étudiés minutieusement, les uns après les autres et qui, assemblés comme le seraient les pièces d’un puzzle, forment un univers sur lequel on peut zoomer, pour en observer telle ou telle figure. Emile Zola propose moins de personnages, puisqu’il suit une famille en particulier, mais il veut montrer les liens de causalité qui enchainent les êtres les uns aux autres, et la façon dont ils sont liés, aussi, à l’univers social qui les entoure ; or dans cet univers, on trouve des rapports politiques, économiques, mais aussi des objets, des industries qui les produisent, et les énergies qui alimentent cette industrie. Et les moyens de locomotion sont un rouage essentiel de ce monde dont Zola veut exposer la mécanique.
C’est cette intention scientifique, qui vise à observer les existences humaines comme on étudierait des phénomènes naturels non humains, qui fait qu’Emile Zola n’est pas seulement un écrivain réaliste. D’ailleurs lui-même se méfie de cette appellation, dont il confie dans un article[12] consacré au réalisme artistique, qu’il cerne mal de quoi il s’agit, au sens où pour lui toute œuvre figurative, en représentant le monde, fait en sorte que cette représentation semble réelle. Ce qu’il vise, lui, consiste moins à représenter de façon réaliste la société qu’il observe, qu’à l’étudier de manière scientifique, en la décrivant évidemment, mais aussi en menant des expérimentations sur ce milieu qu’il observe, en y provoquant des événements, comme on le ferait en chimie dans un laboratoire. S’il fallait donner un nom au genre de roman qu’il écrit, il faudrait alors dire qu’il s’agit de roman expérimental[13].
« Au retour » indique qu’on saisit la scène alors qu’elle se déroulait déjà auparavant. Cet « avant » de la scène à laquelle on va assister se situe dans le temps de cette scène (ces personnages qui rentrent du bois de Boulogne y sont forcément venu quelques heures plus tôt), mais Zola le situe aussi dans l’épisode précédent de la série, le premier roman de la sérié la Fortune des Rougon. L’incipit de la Curée est donc inscrit deux fois dans le temps : une fois dans le temps du récit (la scène elle-même, qui suit celle qu’on ne peut que deviner, c’est-à-dire la promenade au bois de Boulogne en cet après-midi d’octobre), et le temps de l’écriture (le projet général que constitue les Rougon-Macquart, dont la Curée est, donc, la deuxième saison). Ces deux premiers mots attrapent un mouvement au vol, qui semble être relayé par l’évocation des voitures cheminant sur le bord du lac. Une fois qu’on a en tête que ce sont des véhicules tractés par des chevaux, on se fait une image assez claire de la scène. A un détail près : alors que l’imagination se figure des voitures en mouvement, Zola les freine aussitôt : tout d’abord, la calèche ralentit, jusqu’à marcher au pas, puis toutes les voitures s’arrêtent pour de bon. A partir de là, jusqu’à la fin de ce passage, ces attelages vont rester à l’arrêt, et on assiste à ce qu’on appelle aujourd’hui un embouteillage.

La dynamique particulière de l’establishment
Il se passe alors ce qui se passe dans tout embouteillage : on s’observe. Et c’est l’occasion pour Emile Zola de se livrer à une description minutieuse de cet ensemble de voitures, dont on découvre peu à peu qu’elles sont apparentées à la tenue que portent les différents personnages coincés sur ce chemin du Bois de Boulogne, le temps de cette scène. Et on le devine, tout le paradoxe de cette situation tient dans le fait que, non seulement, ces véhicules sont censés se déplacer, et ce plutôt rapidement pour certains d’entre eux, mais les bourgeois qui s’observent de voiture en voiture, qui évaluent l’ascension sociale de l’un, la déchéance de l’autre, sont eux-mêmes pris dans le paradoxe du mouvement et de l’arrêt : Parce qu’ils ont soif d’ascension et parce qu’ils ne cessent de se comparer aux autres, ils ont tendance à vouloir les rattraper, puis les doubler ; c’est ce qui les met en mouvement. Mais le bourgeois se comporte aussi comme un parvenu, du simple fait qu’il appartienne à une classe sociale supérieure, qui peut regarder les autres de haut, à tout point de vue (culturel, économique, social, moral…), et en ce sens, il n’est pas un nomade social, et veut conserver ses acquis, auxquels il s’accroche. Il est donc un sédentaire qui fait mine d’être en mouvement. Un passif qui fait semblant d’être dans l’action.
Toute une classe sociale se trouve immobilisée dans le paysage par le geste littéraire de Zola, alors qu’autour la nature est encore en mouvement : la nuit tombant, le soleil se couche. Et il faudrait lire cette scène comme on regarde le générique de House of Cards. C’est David Fincher, réalisateur des deux premiers épisodes de la série, qui a été chercher le photographe Andrew Geraci, pour construire ce générique en timelapse, qui combine une accélération du temps de la nature, et des plans quasiment fixes sur les bâtiments institutionnels de Washington, dans lesquels et sur lesquels s’exercera le pouvoir à l’œuvre dans cette série politique. Dans ces premières pages de la Curée, Emile Zola joue d’un effet un peu semblable : le temps de la nature suit son cours normal, et c’est le temps humain qui se fige, le mouvement artificiel des voitures s’arrêtant dans son propre élan : tout le monde voulant se déplacer en même temps, chacun est bloqué par chaque autre. La forme naturelle qui envahit littéralement cette scène statique, et la met à elle seule en mouvement, c’est la lumière du soleil couchant. On peut regarder de nouveau le générique d’Andrew Geraci, et observer comment dans ces plans quasiment fixes, c’est le mouvement des ombres projetées par la trajectoire du soleil qui anime les bâtiments figés. Le même phénomène a lieu dans l’entrée en matière de la Curée : les derniers faisceaux du soleil illuminent la scène d’une lumière rasante qui met en valeur les couleurs les plus chaudes (les décors jaunes des voitures, la lumière rousse qui éclaire la tenue des domestiques, rayée de jaune, les boutons cuivrés) ; ceux-ci contrastent avec les aplats plus froids qu’on trouve dans le bleu des carrosseries vernies et les pans plus sombres des tenues des employés. Il faut dire un mot de ces derniers, puisque ce sont les premiers qu’évoque Zola, comme si celui-ci ne respectait pas la hiérarchie : placés en hauteur, parce qu’ils ne sont pas installés à l’intérieur des voitures, ils font partie du cadre naturel décrit dans cette scène, et ils sont aussi les derniers à être frappés par la lumière du soleil. Décrits tout en verticalité, ils se tiennent droit dans la lumière dorée, et Zola les présente comme des repères stables, comme des porteurs de dignité.
Les passagers de la calèche ne sont tout d’abord pas présentés, c’est leur voix qu’on entend, au cours d’un bref échange. Et tout, dans ces quelques mots, évoque la vulgarité : le ton employé (« Vois donc, Renée », on l’entend n’est-ce pas ?), la raillerie, le rire même, la moquerie affichée envers la passagère d’une autre voiture, décrite comme si elle était un objet qu’un nouveau propriétaire aurait repeint pour qu’il soit davantage à son goût. Autant les domestiques sont verticaux, autant ceux qu’ils servent sont immédiatement décrits comme torves, déséquilibrés. Renée, qui est la belle-mère de Maxime, est littéralement vautrée dans la calèche, et doit se redresser en se cramponnant au rebord de la carrosserie pour repérer celle qui est l’objet de leur moquerie. On dit souvent qu’on n’a pas deux fois l’occasion de faire bonne impression. Emile Zola prend un soin tout particulier à gâcher cette première entrevue avec Renée Saccard, en lui consacrant un paragraphe qui la décrit comme une créature grotesque. Des cheveux gras au sourire crétin, c’est bien simple : rien ne va. Elle a beau adopter les signes de la bourgeoisie, les vêtements taillés dans des matières nobles, tout semble, sur elle, déplacé, et ce jusqu’à son comportement : attitude relâchée, mine effrontée, grimace. Rien ne lui est épargné. Et bien sûr, si Laure d’Aurigny est décrite de façon peu valorisante, c’est uniquement parce qu’on la voit à travers le regard persifleur de Renée et Maxime. Pourtant, en fin de paragraphe, alors qu’on a l’impression que la caméra filmant la scène recule pour proposer un plan plus large sur l’embouteillage, on s’échappe de leur regard, et de leur calèche et on découvre Laure d’Aurigny sereine et calme, se tenant droite dans sa voiture à l’arrêt, semblable aux domestiques décrits auparavant, baignant dans la même aura de dignité.
Assez étonnamment, à chaque fois que Zola prend du recul pour proposer un plan large sur ce paysage de bord de lac, il est particulièrement attentif au jeu de la lumière sur les formes, aux couleurs et aux contrastes. Les voitures deviennent des tâches sombres au sein desquelles les reflets du soleil révèlent les détails métalliques, et les parties vitrées. Ce regard très pictural fait énormément penser à la façon dont, au même moment, les peintres impressionnistes représentent non plus le monde lui-même, mais la façon dont la lumière fait resplendir les couleurs, fait jaillir les reflets, les miroitements, les éblouissements, cherchant à restituer l’impression même qu’est le regard sur le monde. La Curée paraît en 1871, et c’est en 1872 que Claude Monnet peint son Impression, soleil levant, qui semble mettre en œuvre sur la toile les principes esthétiques que Zola expérimente dans ces premières pages de la Curée. On n’y voit pas tout à fait clair, et les sons eux-mêmes semblent former une rumeur générale. Dans cette ambiance apaisée, les sonorités semblent feutrées, comme filtrées par le velours des tenues. De voiture à voiture, on ne se parle pas, les conversations se font au loin, parmi les autres. Mais dans l’univers commun du moyen de locomotion privé, c’est le silence qui règne, et on se regarde en chiens de faïence. C’est cette évocation des regards croisés, sans doute lancés un peu en coin et sans véritable échange, qui permet à Zola d’entamer une véritable galerie de portraits, comme autant de plans serrés saisis depuis les habitacles, les uns fermés, les autres grands-ouverts.

Signes extérieurs de vitesse
Cette façon d’associer chaque figure, chaque personnage au véhicule dans lequel il attend que le trafic reprenne fait penser aux arrivées des stars sur les tapis rouges des grandes réceptions mondaines : personne ne songerait à y arriver à pieds. Quand bien même on vient d’un hôtel situé à quelques centaines de mètres à peine, on a loué les services d’un chauffeur et d’une belle automobile, ne serait-ce que pour être vu en descendre. Et bien sûr, on ne passe pas des heures à choisir une belle toilette pour ne pas lui associer, aussi, un véhicule qui soit à la hauteur de l’idée qu’on veut que les autres se fassent de soi. Zola a compris ici que l’ensemble constitué par la voiture et son attelage doit être un témoin de la puissance qui est celle des occupants de l’habitacle. Et finalement, tant mieux si on est dans un embouteillage : c’est encore le meilleur endroit pour se montrer, et jauger les autres du regard. Comme dans les mariages où chaque famille fait mine d’être la plus riche en sortant les tenues les plus onéreuses et les voitures les plus luxueuses, quand bien même personne n’est dupe, et même si on sait très bien que le lundi, tout le monde rapportera soigneusement ce bel attirail et ces panoplies de riche chez le loueur auquel on les a empruntés, l’embouteillage est le moment où, chacun faisant mine de demeurer dans l’intimité de son véhicule, observe néanmoins les autres et évalue son rang sur l’échelle des valeurs bourgeoises, c’est-à-dire dans la hiérarchie de la richesse. Et si la liste s’achève sur les deux académiciens circulant en fiacre, c’est évidemment pour mieux mépriser ces deux individus, dont on n’a vestimentairement rien à dire, et qui circulent ensemble dans une voiture commune, qui était louée le temps d’un après-midi de promenade par exemple, avec son cocher et ses chevaux, évidemment. Emile Zola croise en permanence les tenues et les voitures, précisément parce que ces éléments n’ont plus ici de valeur d’usage : il ne s’agit pas de se protéger du froid, ou de rouler vite, mais de signifier sa puissance économique aux autres, et de faire de la valeur de l’argent dont on dispose, sa valeur propre. Ce que décrit cette ouverture de la Curée, c’est donc une compétition statique, une course suspendue, un salon de l’auto-immobile.
C’est la raison pour laquelle la description s’attarde sur des détails techniques qui pourraient sembler inutiles, puisqu’on est à l’arrêt. Ainsi, on sait quelles races sont attelées à certaines voitures, parce que c’est là l’équivalent des précisions mécaniques qu’on affichait à l’arrière des automobiles dans les années 80 : « V8 », « Turbo », « ABS ». Ces indications n’avaient pas d’autre but que valoriser le propriétaire de la voiture en signalant aux autres qu’il avait les moyens de s’acheter les versions les mieux équipées d’un modèle. De nos jours, des finitions spécifiques sont disponibles dans la plupart des marques, qui simulent la présence d’une mécanique performante, telles que des entrées d’air supplémentaires, ou des jantes de plus grand diamètre, des sorties d’échappement factices, alors que sous le capot se trouve un moteur modeste. Ces modèles sont faits non pas pour rouler vite, puisqu’ils en sont incapables, mais pour donner aux autres l’impression qu’ils pourraient le faire. Et leur terrain de chasse, c’est donc le parking, l’embouteillage, l’aire de repos, l’Eléphant bleu, tous ces lieux où l’automobile peut s’exhiber comme un signe extérieur de vitesse, parce que celle-ci est le témoignage d’une puissance sociale, et d’un potentiel de domination, y compris si cette signalétique relève en fait de la publicité mensongère.
Quand les premières voitures se remettent en route, ce sont de nouveau les impressions picturales qui l’emportent, et puisque le mouvement vient maintenant emporter les éléments visuels dans un grand mélange de formes, de couleurs, de réverbérations, dans un désordre accentué par la pénombre qui tombe peu à peu sur le bois, c’est à un autre mouvement artistique que fait un peu penser Zola ici, le futurisme, qui sera quelques décennies plus tard, l’exaltation de la puissance mécanique, de la vitesse tonitruante, de la confusion visuelle provoquée par l’impossibilité pour le regard de suivre dans le détail le mouvement des automobiles, des locomotives ou des avions. La description que Zola dresse de la mise en branle de tous ces équipages fait penser à la description d’une fête foraine regardée à travers des yeux embués de fatigue ou d’ivresse, ou d’un feu d’artifice. Mais c’est aussi un gigantesque engrenage qui se met en mouvement, une mécanique, et cet effet ne doit sans doute rien au hasard : ce qui intéresse l’auteur, ce n’est pas le portrait de tel ou tel personnage, c’est l’étude de la mécanique générale qui lie les êtres entre eux, qui les fait agir les uns par les autres, comme les pièces d’un même moteur. S’ils s’arrêtent, c’est pour une raison commune, et s’ils se remettent en mouvement, c’est aussi dans une progression partagée et liée, comme si ces véhicules que leurs occupants considèrent comme des voitures particulières n’étaient en réalité que les wagons d’un train commun. Qu’on relise cette simple phrase : « Et le défilé alla, dans les mêmes bruits, dans les mêmes lueurs, sans cesse et d’un seul jet, comme si les premières voitures eussent tiré toutes les autres après elles. » On ne saurait mieux mêler l’individuel, et le collectif.

Madame rêve
Et parce que l’écriture est faite, ici, d’un tressage fait de vues d’ensemble et de gros plans sur l’intérieur de cette calèche, on revient finalement dans l’intimité de la voiture depuis laquelle Renée et Maxime toisent les autres bourgeois auxquels ils se mesurent. Renée Saccard est bercée par la circulation qui reprend. Et ce mouvement langoureux peut être lu de bien des façons. Tout d’abord, c’est le simple fait, pour sa calèche, d’avancer de nouveau et de chalouper sur ses suspensions. Mais c’est aussi l’engrenage de la progression sociale qui reprend son cours, il faut bien avancer sur cette échelle maintenant qu’on s’est jaugé les uns les autres, puisqu’après tout, en tant que membre de la bourgeoisie, on n’est là que pour ça. Mais ce qui motive plus profondément cette progression, c’est tout compte fait le plaisir tout à fait personnel qu’il provoque. Il est impossible de ne pas remarquer la langueur érotique dans laquelle Emile Zola décrit Renée, allongée, abandonnée à sa rêverie au fond de sa calèche, en compagnie de son beau-fils. La peau de bête dans laquelle elle s’emmitoufle pour y trouver un peu de chaleur, ses doigts qui s’égarent et s’entortillent dans la pilosité frisée, la bise qui vient se poser sur elle. La vie bourgeoise vise cette jouissance de l’intimité plaisante vécue sous le regard des autres. Il ne s’agit ni d’entretenir un désir, ni de la satisfaction d’un simple besoin. C’est un processus plus complexe, qui vise à entretenir une permanente envie, chez soi en observant les autres, et chez les autres en s’exposant à leur regard. Ainsi, dans cet embouteillage, chacun souffre du froid, parce qu’on roule capote ouverte, pour être vu ; mais parce qu’il s’agit de conserver un peu de tenue dans l’exposition de soi et l’observation des autres, on se montre tout en se dérobant aux regards, on mate, mais du coin de l’œil, comme à travers les jalousies, ces volets de persiennes orientables qui permettent de voir sans être vu, de demeurer caché tout en étant, malgré tout, entrevu ne serait-ce qu’en ombres chinoises. Car pour faire envie, il faut être en vue.
Si Emile Zola a recours au ralenti pour mieux montrer les détails scintillants de la quincaillerie bourgeoise alors que cette classe sociale met ses habits du dimanche pour sortir au bois, s’il utilise l’embouteillage comme une machine à ralentir le temps, afin de permettre à chaque promeneur de faire, sur le chemin du retour, l’inventaire des richesses du voisin, il utilise le même moyen pour autoriser le lecteur à contempler, le temps d’un instant suspendu, Renée dans toute son afféterie, plongée dans la vie intérieure de ses rêves tristes. Le cours normal du temps ne permettrait pas de saisir au vol tous les détails qui tissent, un à un, son portrait nuancé. L’écriture plie le temps pour l’accommoder au regard. Peu importe la durée réelle de la rêverie de Renée. L’écriture et la lecture nous permettent de nous attarder pour la contempler relever sur elle la fourrure et disparaître sous la neige. Et par un effet de répétition, qui la replonge dans le sommeil dans lequel elle baignait depuis une heure déjà, quelques lignes plus tôt, on ne sait plus si l’écriture de Zola ralentit seulement le temps, ou si elle se permet de le remonter, pour mettre en boucle les songes de Renée.

La vérité des faux-semblants
C’est donc un ensemble de contradictions qui fait le tissu de cet incipit de la Curée. Se montrer tout en se cachant, observer les autres sans échanger avec eux un regard. Ces jeux d’opposition trouvent leur forme accomplie dans cet embouteillage qui est comme un arrêt sur image de ce qui évoque le mieux, à la fin du 19ème siècle, la puissance de déplacement. L’éloge du mouvement, quand il est prononcé par des parvenus qui sont en fait cramponnés à leurs acquis, est toujours suspect ; c’est pourquoi ils aiment acheter, très cher, des objets qui sont l’expression d’une puissance et d’une vitesse qui, en réalité, ne sont jamais mis en œuvre. Il faut des chevaux sportifs en tête d’attelage, et s’ils sont nombreux, la démonstration sera plus éclatante encore au milieu des voitures à l’arrêt. La vitesse, en ce mois d’octobre de la fin du 19ème siècle, est avant tout un message, et si celui-ci nous atteint si facilement, c’est parce qu’elle l’est tout autant, encore, au début du 21ème. Elle n’est pas désirée en tant que telle, parce que plus on va vite, moins on est vu, et dans un monde où quitter sa place, c’est risquer de la perdre, la bourgeoisie a compris que les signes de vitesse valent mieux que la vitesse elle-même. On se déclare d’autant plus en marche qu’en réalité, on ne veut rien d’autre que conserver sa place. Et se mentant à elle-même tout autant qu’elle trompe le monde, cette classe sociale peste contre les ralentissements et exprime son impatience, sans admette que, finalement, son milieu naturel, c’est l’embouteillage. Mais le milieu naturel, dans un roman, c’est une reconstruction, dans tous ses aspects. On sait qu’Emile Zola, dans ce passage, réécrit un article paru dans le Figaro[14] le 10 avril 1870. Mais la matière qu’il manipule dans cette ouverture, au point de la sculpter littéralement, c’est le temps. Censé être accéléré par les moyens de locomotion, celui-ci est ici figé, suspendu, permettant au regard de se promener dans les détails imperceptibles des tenues, des attitudes, des regards. Un tel ralenti, poussé à l’extrême, est un motif esthétique habituel pour nous, mais il est encore, pour un lecteur du 19ème siècle, un effet spectaculaire, qui permet de contempler ce qui ne se voit pas, et d’observer comme à travers un microscope ce qui, à vitesse réelle, se déroberait au regard. Et ce faisant, Emile Zola nous donne une bonne définition de la bourgeoisie : c’est une classe sociale qui simule la vitesse pour camoufler son propre arrivisme, qui observe le monde au ralenti, pour mieux doubler les autres ; et parce que cette classe sociale, plus encore que les autres, doit lutter pour se maintenir, parce qu’elle n’est pas éternellement soutenue par l’au-delà comme croit l’être la noblesse, et parce qu’elle refuse d’être liée aux cycles de la matière comme leur est lié le prolétariat, elle met en scène son hypothétique maîtrise du temps, se donnant en spectacle dans tout ce que la technique propose comme simulacres de vitesse, prenant d’elle-même des images saisies en slow-motion, pour mieux faire illusion. Pour autant, elle n’échappe à la règle de la nature : le temps se joue d’elle plus qu’elle ne joue du temps. Seules les œuvres d’art, dans une puissance d’illusion qui n’est, elle, pas illusoire, peuvent saisir ce qui, sinon, est emporté par le glissement de terrain universel qu’est le monde, en conserver les détails éphémères, capter ce qui ne fait que passer pour, ensuite, débarrassant ce mouvement intime de tout ce qui l’encombre, le restituer sans fin, comme en un éternel « au retour ».
Petite galerie de portraits des voitures hippomobiles participant à cet embouteillage :
La calèche :

Le coupé :

La huit-ressorts

Victoria

Cab

Dog- cart


Fiacre

Documents consultés pour établir ce commentaire du texte de Zola :
– Dossier d’analyse de ce passage établi par Michèle BRUN, du Lycée Victor Hugo, Marseille :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/incipit-curee-genese.pdf
– Nomenclature des voitures à cheval :
http://cheval.culture.fr/fr/glossaire/A
– Un article de Marie-Ange Voisin-Fougère : Le sérieux et la feinte. Le bourgeois dans la littérature réaliste
https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1995_num_25_87_2970
– Une étude de Thierry Mézailles sur la présence des véhicules dans la littérature réaliste : Rôles thématiques et narratifs des véhicules hippomobiles dans le roman réaliste, sur son propre site :
http://mezaille.chez.com/vehippo.htm
– Le générique de la série House of cards
– L’étude de ce générique :
House of Cards: tout sur le générique en timelapse
[1] Eugène GUERARD (Nancy 1821-1866) La promenade en calèche
[2] Filet décoratif en peinture
[3] Le nom de Laure d’Aurigny rappelle le nom d’une actrice célèbre de l’époque : Blanche d’Antigny. Celle-ci inspirera encore, dix ans plus tard, certains traits du personnage de Nana.
[4] Huit-ressorts : voiture suspendue sur huit ressorts, donc une des catégories de voitures les plus confortables et les plus luxueuses.
[5] Victoria : voiture découverte à quatre roues.
[6] Cab : sorte de cabriolet d’invention anglaise, où le cocher est placé à l’arrière. Le cab fut introduit à Paris en 1852.
[7] Stapper : il désigne un cheval racé et rapide comme un cheval de course.
[8] Coupé-égoïste : petit coupé étroit à un seul cheval, et une seule place.
[9] Dog-cart : voiture légère à deux roues très élevées. A l’origine, voiture servant à la chasse, et dans la caisse de laquelle on pouvait loger des chiens.
[10] Mail : abréviation de mail-coach (de l’anglais mail : malle, et coach : voiture). Voiture suspendue couverte, attelée de quatre chevaux.
[11] Incipit : on appelle ainsi les premiers mots d’un texte, d’un discours. Le mot latin signifie « ça commence »
[12] « Je serais désespéré si mes lecteurs croyaient un instant que je suis ici le porte-drapeau d’une école. Ce serait bien mal me comprendre que de faire de moi un réaliste quand même, un homme enrégimenté dans un parti. Je suis de mon parti, du parti de la vie et de la vérité, voilà tout. J’ai quelque ressemblance avec Diogène, qui cherchait un homme; moi, en art, je cherche aussi des hommes, des tempéraments nouveaux et puissants. Je me moque du réalisme, en ce sens que ce mot ne représente rien de bien précis pour moi. Si vous entendez par ce terme la nécessité où sont les peintres d’étudier et de rendre la nature vraie, il est hors de doute que tous les artistes doivent être des réalistes. Peindre des rêves est un jeu d’enfant et de femme; les hommes ont charge de peindre des réalités. Ils prennent la nature et ils la rendent, ils la rendent vue à travers leurs tempéraments particuliers. Chaque artiste va nous donner ainsi un monde différent, et j’accepterai volontiers tous ces divers mondes, pourvu que chacun d’eux soit l’expression vivante d’un tempérament. J’admire les mondes de Delacroix et de Courbet. Devant cette déclaration, on ne saurait, je crois, me parquer dans aucune école. » « Une œuvre d’art est un coin de la création vu à travers un tempérament »
Emile Zola, les Réalistes au salon, L’Evénement, 11 mai 1866
[13] « Dans mes études littéraires, j’ai souvent parlé de la méthode expérimentale appliquée au roman et au drame. Le retour à la nature, l’évolution naturaliste qui emporte le siècle, pousse peu à peu toutes les manifestations de l’intelligence humaine dans une même voie scientifique. Seulement, l’idée d’une littérature déterminée par la science, a pu surprendre, faute d’être précisée et comprise. Il me paraît donc utile de dire nettement ce qu’il faut entendre, selon moi, par le roman expérimental. Je n’aurai à faire ici qu’un travail d’adaptation, car la méthode expérimentale a été établie avec une force et une clarté merveilleuses par Claude Bernard, dans son Introduction à l’étude de la médecine expérimentale […]
Eh bien! en revenant au roman, nous voyons également que le romancier est fait d’un observateur et d’un expérimentateur. L’observateur chez lui donne les faits tels qu’il les a observés, pose le point de départ, établit le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se développer les phénomènes. Puis, l’expérimentateur paraît et institue l’expérience, je veux dire fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y montrer que la succession des faits y sera telle que l’exige le déterminisme des phénomènes mis à l’étude. C’est presque toujours ici une expérience « pour voir » comme l’appelle Claude Bernard. Le romancier part à la recherche d’une vérité. Je prendrai comme exemple la figure du baron Hulot, dans la Cousine Bette, de Balzac. Le fait général observé par Balzac est le ravage que le tempérament amoureux d’un homme amène chez lui, dans sa famille et dans la société. Dès qu’il a eu choisi son sujet, il est parti des faits observés, puis il a institué son expérience en soumettant Hulot à une série d’épreuves, en le faisant passer par certains milieux, pour montrer le fonctionnement du mécanisme de sa passion. Il est donc évident qu’il n’y a pas seulement là observation, mais qu’il y a aussi expérimentation, puisque Balzac ne s’en tient pas strictement en photographe aux faits recueillis par lui, puisqu’il intervient d’une façon directe pour placer son personnage dans ses conditions dont il reste le maître. Le problème est de savoir ce que telle passion, agissant dans tel milieu et dans telles circonstances, produira au point de vue de l’individu et de la société; et un roman expérimental, la Cousine Bette par exemple, est simplement le procès-verbal de l’expérience, que le romancier répète sous les yeux du public. En somme, toute l’opération consiste à prendre les faits dans la nature, puis à étudier le mécanisme des faits, en agissant sur eux par les modifications des circonstances et des milieux, sans jamais s’écarter des lois de la nature. Au bout, il y a la connaissance de l’homme, la connaissance scientifique, dans son action individuelle et sociale. […]
Sans me risquer à formuler des lois, j’estime que la question d’hérédité a une grande influence dans les manifestations intellectuelles et passionnelles de l’homme. Je donne aussi une importance considérable au milieu. Il faudrait sur la méthode aborder les théories de Darwin; mais ceci n’est qu’une étude générale expérimentale appliquée au roman, et je me perdrais, si je voulais entrer dans les détails. Je dirai simplement un mot des milieux. Nous venons de voir l’importance décisive donnée par Claude Bernard à l’étude du milieu intra-organique, dont on doit tenir compte, si l’on veut trouver le déterminisme des phénomènes chez les êtres vivants. Eh bien! dans l’étude d’une famille, d’un groupe d’êtres vivants, je crois que le milieu social a également une importance capitale. […]L’homme n’est pas seul, il vit dans une société, dans un milieu social, et dès lors pour nous, romanciers, ce milieu social modifie sans cesse les phénomènes. Même notre grande étude est là, dans le travail réciproque de la société sur l’individu et de l’individu sur la société. »
Emile Zola, le Roman expérimental, 1880
[14] « Avec le soleil, toute la haute gentry s’est montrée hier au bois de Boulogne. Citons au passage: la princesse de Metternich, en huit-ressorts; madame de Mercy-Argenteau, en victoria très correctement attelée la baronne de Rothschild, sur un ravissant cab bai-brun ; la comtesse Walewska, avec ses poneys pie; madame Olympe Aguado, et ses fameux stappers noirs; Émile Augier, en fiacre, revenant de chez Jules Janin ; Augustine Deveria, dans un victoria vert foncé la princesse Clotilde, Isabelle la catholique, en grand deuil, avec ses trois enfants et sa livrée antique et solennelle ; Pierre Bonaparte, en victoria avec son chapeau gris et son fidèle commandant; Hussein Pacha, avec son fez et sans son gouverneur la princesse de Sagan, en coupé-égoiste, avec sa livrée poudrée à blanc; madame Rolle, en superbe landau découvert et nos deux jolies maréchales; la charmante madame Laure Baignières; toute la colonie hispano-américaine et le stage à quatre de M. Wilkinson, etc. Total 2 322 voitures ou cavaliers comptés â la grille du Bois par un employé de la voirie chargé de ce service depuis deux heures jusqu’à six. »
Le Figaro, 10 avril 1870, Échos de Paris