Les salles obscures sont rarement aussi sombres que lorsqu’on y projette un film de David Cronenberg. On aurait pu avoir l’illusion d’une éclaircie, dans A dangerous method, s’il ne s’était agi, comme toujours chez lui, de plonger dans le confinement de ces psychismes dont les actes souterrains secouent le corps de séismes monstrueux. Retour au noir, dans quelques jours avec Cosmopolis, qui est l’adaptation cinématographique de l’oeuvre d’un des plus grands écrivains américains contemporains, Don DeLillo, qu’on ne saurait pas trop comment présenter, tant il est typiquement un auteur américain, c’est à dire un de ces types qui, comme dans Dark City, vous construisent un monde dont ils maîtrisent tous les rouages, toutes les correspondances, le moindre détail et la manière dont celui ci aura des conséquences sur les autres détails de l’univers dont ils sont maîtres, et tant il est aussi, pourtant, une voix singulière parmi ces architectes. Lire  DeLillo, c’est avant tout être largué dans un univers auquel il faut faire confiance, car bien souvent, on ne sait pas où on se trouve, ni avec qui. Les informations viennent en temps et en heure, mais ce flou évite de se focaliser sur ce qui n’est pas essentiel, et dans Cosmopolis, c’est particulièrement important, puisque c’est le roman de la dématérialisation, de la pure circulation et de la délocalisation. On trouve des repères qui semblent provenir de la vie telle qu’on la mène, mais plus on avance, et plus on se rend compte que pourtant, il ne s’agit ni de sa vie, ni de l’espace qu’on occupe d’habitude.
DeLillo, c’est avant tout être largué dans un univers auquel il faut faire confiance, car bien souvent, on ne sait pas où on se trouve, ni avec qui. Les informations viennent en temps et en heure, mais ce flou évite de se focaliser sur ce qui n’est pas essentiel, et dans Cosmopolis, c’est particulièrement important, puisque c’est le roman de la dématérialisation, de la pure circulation et de la délocalisation. On trouve des repères qui semblent provenir de la vie telle qu’on la mène, mais plus on avance, et plus on se rend compte que pourtant, il ne s’agit ni de sa vie, ni de l’espace qu’on occupe d’habitude.
C’est que DeLillo s’intéresse aux structures, aux formes générales de la vie que nous partageons, ce qui n’est pas étonnant, puisque comme tout écrivain, son matériau est le langage, et que le langage humain est l’élément structurant du monde que l’homme habite. Dans Cosmopolis, c’est l’argent qui est au centre de l’unité de temps, de lieu et d’action dans laquelle on est enfermé, et qui prend la forme d’une limousine bloquée dans le trafic, au beau milieu de New-York. Mais l’argent est absent, puisqu’il est partout ailleurs, et que la limousine n’est que l’antenne depuis laquelle on peut le discerner, le repérer et le contrôler. C’est quasiment l’équivalent du télépod dans La Mouche sauf que, bien qu’automobile, elle n’est pas ce par quoi l’homme va aux choses (d’ailleurs, du début à la fin du roman, elle est arrêtée par les embouteillages, à tel point d’ailleurs que cette immobilité de ce qui jusque là était le symbole du mouvement au coeur du flux financier incessant constitue la structure intime du roman, qui nous fait toucher du doigt le caractère singulier du monde tel qu’on le vit depuis quelques décennies, avec ses délocalisations, ses désindustrialisations et sa financiarisation : on y gagne plus d’argent en immobilisant la marchandise qu’en la vendant), elle est plutôt ce par quoi les choses viennent à l’homme, ou ce qui permet à l’homme de faire transiter les choses. A partir du moment où le mouvement dématérialisé de l’argent remplace le déplacement des choses, il importe peu que l’homme soit plutôt ici qu’ailleurs puisque la progression de l’homme n’est plus le sujet de l’histoire, dont le progrès réclame au contraire que l’homme, au sens générique du terme, s’arrête et se mette au service d’autre chose, qui n’aura plus d’humain que le nom.
Ce qui est satisfaisant avant même de voir le film de Cronenberg, dans la simple idée qu’il ait adapté ce roman, c’est justement qu’en le lisant, on sait qu’on est extrêmement proche de ce que le réalisateur d’Existenz travaille, depuis le début de sa carrière cinématographique. C’est tout juste, même, si le roman, malgré sa brièveté, ne pose pas les thèmes cronenbergiens comme autant de bornes sur le côté de la courte route parcourue par la limousine d’Eric Parker : la téléportation, c’est à dire le déplacement immédiat, via la dématérialisation, en somme, le pur flux; la fusion homme/machine, et donc l’hybridation, avec tout ce que cela implique, qui ferait presque qu’on pourrait imaginer que tout hybride participe de l’hybris (ce qu’étymologiquement on ne peut pas établir, l’idée était plaisante, mais à strictement parler, elle n’est pas valide); la production d’une surhumanité dédaigneuse, sous la forme de ce qu’on appellerait aujourd’hui une hyper-bourgeoisie, dont on ne sait même pas si elle est encore attaché à l’humain, ou si elle vise sa destruction; les trous dans le corps humain, comme autant de vecteurs par lesquels l’expérience peut se vivre, que ce soit la possibilité d’insérer l’expérience dans le corps (le corps qui devient lecteur de VHS dans Videodrome, ou unité centrale de jeu video dans Existenz), ou la perspective d’atteindre un sur-plaisir (la puissance du principal protagoniste de la Mouche, qui entrevoit comme augmentation ce que tout le monde regarde comme une destruction abominable, ou la jouissance recherchée et trouvée dans les plaies béantes, les cicatrices, les moignons résultants d’amputations et la tôle froissée emboitée dans le corps humains, dans Crash), ou bien encore, ici, le pistolet automatique braqué par la main même de Parker sur sa propre autre main, et le doigt qui appuie sur la détente; enfin, la mise à distance immédiate de l’expérience par l’image, en somme si on résume, le devenir-image de l’homme. Et si ce n’est pas, éminemment, un thème cinématographique, on ne sait plus ce que c’est que le cinéma. Dès lors, sans même avoir vu Cosmopolis, puisqu’il n’est pas encore sorti, on devine qu’un des éléments forts de sa réussite, c’est le fait d’avoir casté Robert Pattinson, à l’envers même de ce qu’aurait fait un Robert Bresson, qui détestait recourir à des vedettes, parce qu’elles vampirisaient le personnage (à moins que,  précisément, Pattinson soit la synthèse ultime de la vedette et de ce que Bresson appelle un « modèle ») : cinématographiquement, Pattinson n’est pas répertorié comme un être humain. Ses rôles l’ont massivement conduit vers l’inhumanité, et il est par excellence un acteur numérique, dont on a bel et bien l’impression que, si on tendait la main vers lui, elle le traverserait sans parvenir à rien en saisir. On devrait le filmer nu, tant son corps relève plus de l’absence que de la matérialité. Une pure image, parfaite évidemment, une abstraction. Un être qui semble créé pour Cronenberg, et par lui peut être bien, ou du moins par ce qu’il a fait du cinéma.
précisément, Pattinson soit la synthèse ultime de la vedette et de ce que Bresson appelle un « modèle ») : cinématographiquement, Pattinson n’est pas répertorié comme un être humain. Ses rôles l’ont massivement conduit vers l’inhumanité, et il est par excellence un acteur numérique, dont on a bel et bien l’impression que, si on tendait la main vers lui, elle le traverserait sans parvenir à rien en saisir. On devrait le filmer nu, tant son corps relève plus de l’absence que de la matérialité. Une pure image, parfaite évidemment, une abstraction. Un être qui semble créé pour Cronenberg, et par lui peut être bien, ou du moins par ce qu’il a fait du cinéma.
En somme, comme tout grand cinéaste, Cronenberg ne nous parle, en fait, que de cinéma, et pas tout à fait de la manière dont le fait ‘the Artist‘… Si on a en mémoire La Mouche, on se souvient que derrière les histoires d’hybridation entre homme, animal et machine, il y a la réalisation de l’hybridation entre le cinéma et la vidéo. Or, sur la question du mouvement, c’est un passage crucial; car si le cinéma est un art de la mise en mouvement par l’accumulation de ce qui est fixe (comme le capitalisme industriel consiste en l’enrichissement par la mise en mouvement de la matière inerte), la video, elle, et ce tout particulièrement lorsqu’elle devient numérique, ne s’appuie plus sur une illusion de mouvement issue de la multiplication du fixe : son image procède du balayage numérique, elle EST mouvement puisqu’aucune image fixe ne peut réellement en être tirée. A strictement parler, si le mouvement doit permettre d’isoler des instants, alors l’image numérique ne relève plus du mouvement, mais d’un concept plus abstrait encore, qu’on pourrait appeler « circulation ». Il y a donc dans la numérisation du cinéma un processus de dématérialisation identique à celui qui frappe les économies, et donc les échanges humains : il s’agit de devenir flux, phénomène ondulatoire qui sera observé et expliqué davantage par les fractales que par la physique. Et c’est pour cela que les fictions telles que Margin Call, qui persistent à tenter de décrire les phénomènes financiers sous la forme d’une mécanique, qu’elle soit économique, informatique ou psychologique, échouent, même s’ils sont brillants, parce que ce n’est pas en filmant des hommes en action qu’on peut saisir ce qui se joue, mais en filmant tout court.
C’est de ceci qu’il s’agit dans Cosmopolis, d’une concentration du mouvement dans l’immobile, ce qui explique sans doute en partie pourquoi la matière même du roman s’est singulièrement condensée, si on la compare, par exemple, à Outremonde. Certains pourraient d’ailleurs reprocher à Cosmopolis qu’il ne s’y passe rien, ou pas grand chose, mais ce serait reprocher à DeLillo le principe même de son écriture, désirer qu’il soit un autre auteur. Ce processus de mise en évidence des flux à travers l’immobilité est tellement au coeur de son écriture qu’il en fait un thème esthétique manifeste dans Point Omega, à travers la figure de l’oeuvre plastique de Douglas Gordon, 24 Hour Psycho, qui ralentit la projection de Psychose, de Hitchcock, jusqu’ à en tirer un mouvement de vingt-quatre heures. Si on a compris le principe, on devine quel enjeu littéraire porte le dernier roman de DeLillo, intitulé l’Homme qui tombe, et la manière dont il s’empare du 11 Septembre 2001.
Il n’est donc question que du mouvement spécifique qui anime notre temps, qui n’est plus la mise en branle d’un élément primordial fixe, mais mouvement dématérialisé. Et il s’agit donc d’observer comment l’homme peut habiter ce flux. On trouve donc dans Cosmopolis une expérience qui permet d’intégrer une majeure part des problématiques liées à la question des échanges tels qu’ils se pratiquent désormais. On sait qu’il est difficile de proposer, à propos de l’argent, une écriture plus pointue que celle de Marx lui même, tant l’analyse et la nécessaire ironie que réclame le rapport que nous avons à cet intermédiaire mouvant semblent être quasiment indépassables, tant surtout ces textes paraissent aujourd’hui prophétiques. Cependant, dans la catégorie des comptables qui passent le monde au crible de leurs audits, DeLillo appartient au grade des experts. Je résume la situation qui encadre l’extrait qui suit : Manhattan, 6th Avenue,West side. Une limousine bloquée par le cortège présidentiel, une rupture de canalisation et l’enterrement d’une star du rap. Un homme, une femme, une de ses comptables, dans la limousine, qui y discutent « argent » :
» ‘Il nous faut réfléchir à l’art de gagner de l’argent’, dit-elle.
Elle était sur le siège arrière, sa place à lui, le fauteuil club, il la regardait, il attendait.
‘les grecs ont un mot pour ça’
Il attendit.
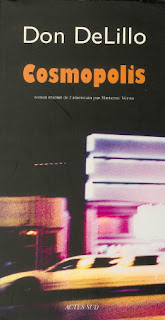 ‘Chrimatistikos, dit-elle. Mais il faut donner un peu de souplesse au mot. L’adapter à la situation actuelle. Parce que l’argent a pris un virage. Toute fortune est devenue une fortune en soi. Il n’y a plus d’autre sorte d’énorme fortune. l’argent a perdu son caractère narratif de même que la peinture l’a perdu jadis. L’argent se parle à lui-même.’
‘Chrimatistikos, dit-elle. Mais il faut donner un peu de souplesse au mot. L’adapter à la situation actuelle. Parce que l’argent a pris un virage. Toute fortune est devenue une fortune en soi. Il n’y a plus d’autre sorte d’énorme fortune. l’argent a perdu son caractère narratif de même que la peinture l’a perdu jadis. L’argent se parle à lui-même.’
D’habitude elle portait un béret mais elle était nu-tête aujourd’hui, Vija Kinski, une petite femme en chemisier strict boutonné, avec un vieux gilet brodé et une longue jupe plissée mille fois lessivée, sa responsable du service Recherche et analyse conceptuelle, en retard pour leur réunion hebdomadaire.
‘Et la propriété suit, bien sûr. Le concept de propriété se modifie de jour en jour, d’heure en heure. Les dépenses énormes que font les gens pour acquérir de la terre et des maisons et des bateaux et des avions. Ca n’a rien à voir avec la confiance en soi à l’ancienne, d’accord. La propriété n’est plus une affaire de pouvoir, de personnalité et d’autorité. Elle n’est plus une affaire d’étalage de vulgarité ou de goût. Parce qu’elle n’a plus ni poids ni forme. La seule chose qui compte c’est le prix que vous payez. Toi-même, Eric, réfléchis. Qu’est ce que tu as acheté pour cent quatre millions de dollars ? Pas des dizaines de pièces, des vues incomparables, des ascenseurs privés. Pas la chambre à coucher rotative ni le lit informatisé. Pas la piscine ni le requin. Les droits aériens peut-être ? Les capteurs à régulation et l’informatique ? Pas les miroirs qui te disent comment tu te sens quand tu te regardes le matin. Tu as payé pour le chiffre lui-même. Cent quatre millions. Voilà ce que tu as acheté. Et ça les vaut. Les chiffre est sa propre justification.’
La voiture était immobilisée dans la circulation stationnaire à mi-chemin entre les deux avenues, là ou Kinski était montée à bord, émergeantt de l’Eglise de Saint Mary Virgin. C’était curieux mais peut-être pas. Il était en face d’elle sur le strapontin, et se demandait pourquoi il ne savait pas son âge. Elle avait les cheveux gris fumée, comme frappés par la foudre, flétris et roussis, mais son visage était à peine marqué, à l’exception d’un gros grain de beauté sur le haut de la joue.
‘Oh, et cette voiture, que j’adore. La lueur des écrans. J’adore les écrans [Note du moine copiste : on imagine tout à fait Cronenberg lisant cette simple phrase, qui dit évidemment plus que ce qu’elle prononce]. La lueur du cybercapital. Si radieux et séduisant. Ca me dépasse complètement.
Elle parlait en chuchotant presque et arborait un sourire persistant, parcouru de variations énigmatiques.
‘Mais tu sais comme je suis sans vergogne en présence de tout ce qui se prétend idée. L’idée c’est le temps. Vivre dans le futur. Regarde les chiffres qui défilent. L’argent falsifie le temps. Autrefois c’était le contraire. Le temps d’horloge a accéléré la montée du capitalisme. Les gens ont cessé de penser à l’éternité. Ils ont commencé à se concentrer sur les heures, les heures d’homme, en utilisant la main-d’oeuvre plus efficacement. ‘
Il dit : ‘Il y a une chose que je veux te montrer.
– Atttend. Je réfléchis.’
Il attendit. Elle avait un sourire un peu de travers.
‘C’est le cybercapital qui crée le futur. Quelle est la mesure qu’on appelle nanoseconde ?
– dix à la puissance moins neuf.
– C’est quoi.
– Un milliardième de seconde, dit-il.
– Ca me dépasse complètement. Mais ça me dit avec quelle rigueur nous devons prendre la mesure adéquate du monde qui nous entoure.
– Il y a des zeptosecondes.
– Tant mieux. J’en suis ravie.
– Des yoctosecondes. Un septilionième de seconde.
– Parce que le temps est désormais une valeur d’entreprise. Il appartient au système du libre marché. Le présent est plus difficile à trouver. Il est en train d’être aspiré du monde pour laisser place au futur des marchés incontrôlés et à un énorme potentiel d’investissement. Le futur devient insistant. C’est pourquoi il va bientôt se produire quelque chose, peut-être aujourd’hui, dit-elle en regardant dans ses mains d’un air finaud. Pour corriger l’accélération du temps. Ramener la nature à la normale, plus ou moins.’
Le côté sud de la rue était presque désert. Il l’aida à sortir de la voiture et à monter sur le trottoir, d’où ils pouvaient avoir une vue partielle du défilement électronique de l’information boursière, des unités de message animé qui zébraient la façade d’une tour de bureaux de l’autre côté de Broadway. Kinski était tétanisée. C’était très différent des informations qui tournaient tranquillement autour du vieux building de Times Square, à quelques blocs, plus au sud. Là il y avait trois rangées de données courant simultanément à une bonne trentaine de mètres au-dessus de la rue. Informations financières, valeurs en bourse, marchés des devises. L’action ne ralentissait pas. La course infernale des chiffres et des symboles, les fractions, les décimales, le signe du dollar stylisé, le flux continu des mots, des informations multinationales, tout cela trop fugace pour être absorbé. Mais il savait que Kinski l’absorbait.
Il se tenait derrière elle, pointant le doigt par-dessus son épaule. Au-dessous des bandes de données ou téléscripteurs qui défilaient, des chiffres fixes indiquaient l’heure dans les principales villes du monde. Il savait ce qu’elle pensait. Peu importe la vitesse qui rend difficile la lecture de ce qui passe devant les yeux. C’est la vitesse qui compte. Peu importe le renouvellement sans fin, la façon dont les informations se dissolvent à un bout de la série pendant qu’elles se forment à l’autre. C’est ce qui compte, l’élan, le futur. Nous n’assistons pas tant au flux de l’information qu’à un pur spectacle l’information sacralisée, rituellement illisible. Les petits écrans du bureau, de la maison et de la voiture deviennent ici une sorte d’idolâtrie, ici les foules pourraient se rassembler dans la stupéfaction.
Elle dit : ‘Est ce que ça ne s’arrête jamais ? Est ce que ça ralentit ? Bien sûr que non. Pour quoi faire ? Fantastique.’
Don DeLillo – Cosmopolis p.88 sq
A lire ces lignes, on mesure à quel point notre finance réactive le dualisme ancestral de la matière et de l’idée. Ce n’est dès lors pas tout à fait un hasard si on retrouve cette opposition travaillée par Gunther Anders dans le second volume de son Obsolescence de l’homme, sous titré ‘Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle‘. Gunther Anders, c’est au vingtième siècle l’un des plus importants penseurs de la fusion de l’homme et de la machine. Il faut lire son Nous, fils d’Eichman pour saisir toute la gravité de la réflexion qu’il construit, affirmant que le monde lui même devient machine, que l’homme n’y a de place qu’en tant que rouage et que la défaite du nazisme n’est pas un temps d’arrêt pour ce processus. Au tout début de l’Obsolescende de l’homme, on trouve une page, intitulée, ‘L’obsolescence du matérialisme‘, écrite en 1978. Anders y diagnostique le malentendu que nous entretenions alors, déjà, quant à la véritable essence du monde que nous avons construit, déplorant qu’il soit à ce point matérialiste alors que dans le fond, le simple fait qu’on commence à y vivre en accumulant dettes, crédits et bulles économiques aurait dû nous mettre la puce à l’oreille, et nous amener à constater qu’en réalité, le matière appartenait au vieux monde dont on venait de se découpler. Mais si ce texte est intéressant, c’est qu’il repère ce divorce au sein même de la production industrielle, alors qu’il s’agit encore de marchandise concrète :
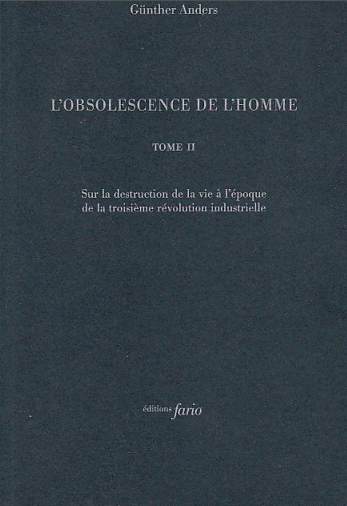 « Ce n’est pas à l’époque du matérialisme que nous vivons, comme s’en plaignent les esprits bornés, mais à celle du second platonisme. Pou la première fois aujourd’hui, à l’époque de l’industrie de masse, l’objet particulier a effectivement un degré d’être inférieur à son ‘Idée’, à son blue print. Que vaut l’ampoule de la marque Untel qui porte le numéro de série 784653930, à côté de son modèle non-physique ? Elle n’est qu’une simple copie de l’Idée et ce faisant un mè on, un non étant. Ce n’est pas parce que nous avons réussi à fabriquer trois bombes atomiques que nous sommes entrés dans l’ère atomique, mais parce que nous possédons depuis lors la recette pour en fabriquer de nombreuses autres. L’Union soviétique n’était alors pas menacée par l’existence de quelques objets physiques mais par leur ‘Idée’. Si un vol avait effectivement dû avoir lieu à l’époque, ce ne sont pas quelques objets qui auraient été dérobés mais les plans qui en étaient les modèles.
« Ce n’est pas à l’époque du matérialisme que nous vivons, comme s’en plaignent les esprits bornés, mais à celle du second platonisme. Pou la première fois aujourd’hui, à l’époque de l’industrie de masse, l’objet particulier a effectivement un degré d’être inférieur à son ‘Idée’, à son blue print. Que vaut l’ampoule de la marque Untel qui porte le numéro de série 784653930, à côté de son modèle non-physique ? Elle n’est qu’une simple copie de l’Idée et ce faisant un mè on, un non étant. Ce n’est pas parce que nous avons réussi à fabriquer trois bombes atomiques que nous sommes entrés dans l’ère atomique, mais parce que nous possédons depuis lors la recette pour en fabriquer de nombreuses autres. L’Union soviétique n’était alors pas menacée par l’existence de quelques objets physiques mais par leur ‘Idée’. Si un vol avait effectivement dû avoir lieu à l’époque, ce ne sont pas quelques objets qui auraient été dérobés mais les plans qui en étaient les modèles.
Breveter une invention signifie, comme tout le monde le sait, protéger une idée afin d’éviter qu’elle soit copiée et utilisée. Platon n’avait pas imaginé qu’il y aurait un jour une propriété des ‘Idées’ et qu’on chercherait à protéger juridiquement cette propriété.
Comparé aux quelques Idées du ciel platonicien, le nombre de nos ‘Idées’ actuelles est infini et croît indéfiniment : il croît chaque jour vers l’infini en raison de l’inflation des inventions (que Platon ne définit nulle part comme des ‘élaborations d’Idées’). Si tôt ou tard nous périssons (ce sera vraissemblablement bientôt), nous serons alors victimes du second platonisme. «
Gunther Anders – L’obsolescence de l’homme, p. 39
Qu’on ait pu deviner, dès les années 70, que le monde intelligible serait frappé à son tour, d’une inflation telle qu’on ne pourrait même plus le penser, voila une intuition qui en dit peut être assez long sur cette perte de sens qui a ceci de particulier qu’il semble de plus en plus difficile d’en dire quoi que ce soit, puisqu’elle vérole la langue elle-même, la pliant à ses exigences. On sait que, chez Platon, quand le contact avec l’Idée est perdu, que le discours ne parvient pas à en rendre compte, il reste une interface possible, qui est l’image. Peut être, dès lors, qu’au lieu des sophismes d’économistes qui, posés les uns à côté des autres, témoignent de l’impossibilité de saisir ce dont on parle, les véritables traités d’économie se trouvent dans les romans, films, fictions au sens large qui parviennent à absorber la circulation qui constitue le mouvement de ce monde, à défaut d’en être le mouvement vital.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Xrwp8gxyZb4[/youtube]
Pour nos élèves, on précise que, de nouveau, DeLillo et Anders se trouvent en bonne place au CDI, et n’attendent que votre emprunte sur leurs empreintes.